Charles Huot (1855-1930)

Charles Huot, Le débat sur les langues : séance de l’Assemblée législative du Bas-Canada le 21 janvier 1793, 1910-1913
Huile sur toile marouflée sur le mur, 3,9 x 8,7 m
Salle de l’Assemblée nationale, Assemblée nationale du Québec, Québec
À la mi-août 1904, en entrant dans le magasin de Gaspard Huot, rue Saint-Jean à Québec, le riche industriel Georges-Élie Amyot se porte acquéreur d’œuvres de Charles Huot, un peintre local. Il s’agit de deux scènes champêtres exécutées à l’huile et deux aquarelles représentant le monastère des Ursulines où avait étudié son épouse. Son geste a des répercussions dans la presse : « Bel exemple » titre quelques jours plus tard le journal Le Soleil qui félicite « ce citoyen aisé de donner la préférence au commerce indigène plutôt que de faire venir de l’étranger, à grands frais, des tableaux qui souvent ne valent pas mieux que ce que peut produire l’art national. » Si Huot pratique la peinture de paysage, c’est à titre de peintre de l’histoire nationale qu’il marquera les arts à Québec, notamment avec une peinture comme Le débat sur les langues : séance de l’Assemblée législative du Bas-Canada le 21 janvier 1793.
Formé à la discipline de la tradition académique française dans l’atelier d’Alexandre Cabanel (1823-1889) et à l’École des beaux-arts de Paris, Huot passe douze ans en Europe, de 1874 à 1886. Il revient à Québec pour répondre à une commande de décoration à l’église Saint-Sauveur. Par la suite, plusieurs autres églises et congrégations religieuses lui commanderont des œuvres de décoration. En 1900, Huot bénéficie d’une exposition particulière à l’hôtel du Parlement, après quoi sa notoriété ne cessera de s’affirmer, ce dont témoigne l’acquisition de ses œuvres par Amyot en 1904.
-
Charles Huot, La leçon de couture, 1886
Huile sur toile, 66 x 126 cm
Musée des beaux-arts de Montréal
-
Charles Huot, Cinghalais fumant le narguilé, 1905/1906
Huile sur toile, 81,3 x 121,3 cm
Musée national des beaux-arts du Québec, Québec
-
Charles Huot, La bataille des plaines d’Abraham, v.1900
Huile sur toile, 25,5 x 58,4 cm
Musée Royal 22e Régiment, Québec
L’exposition de 1900 témoigne de la diversité des genres marquant la carrière du peintre qui les pratique tous, de la peinture d’histoire et religieuse au portrait, et du paysage à la scène de genre qu’il affectionnait particulièrement. Cinghalais fumant le narguilé, 1905/1906, témoigne de cette pratique de la peinture de genre en une composition qui fait la part belle à l’orientalisme, un courant traversant la peinture française du dix-neuvième siècle. Dans un tout autre registre, La leçon de couture, 1886, invite dans un intérieur féminin qui rassemble une poignée de jeunes femmes, le nez sur leurs ouvrages. Le peintre confère beaucoup de réalisme à sa composition, notamment par le point de vue adopté, qui donne l’impression qu’on est à l’intérieur, derrière elles, dans la pièce même où se joue la scène.
Huot atteint la gloire lorsqu’il remporte, en 1910, le concours tant convoité d’une grande décoration historique, intitulée Le débat sur les langues, destinée à la salle de l’Assemblée législative de l’hôtel du Parlement, communément appelée, de nos jours, le Salon bleu. Le thème à « haute teneur symbolique » décrit la controverse suscitée, en 1793, par la proposition d’un député anglophone « voulant que seul le texte anglais ait force de loi. Un vif débat pour la reconnaissance de la langue française s’en [est suivi]. C’est l’intensité de ce moment que le peintre va saisir dans son œuvre ». La reconstitution historique du tableau est l’aboutissement de mois de recherches de la part de l’artiste qui entend dresser le portrait précis des cinquante députés présents en chambre. Dans les fenêtres de l’arrière-plan donnant sur les jardins du séminaire, Huot imagine qu’on y voit le château Saint-Louis, ce qui lui permet « une heureuse métaphore picturale : symbole du pouvoir colonial anglais, mais rappel de l’ancien régime [français], cette ambivalence s’accorde bien avec l’objet des débats qui est la survie de la langue française malgré la puissance politique britannique ». À Québec, Huot laisse sa marque comme peintre officiel ayant œuvré à l’édification de la peinture commémorative.

 À propos de l’autrice
À propos de l’autrice
 Autres livres d’art en ligne
Autres livres d’art en ligne
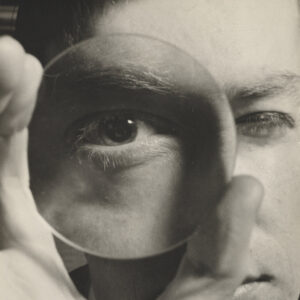 Remerciements
Remerciements