Louis Jobin (1845-1928)

Louis Jobin, Notre-Dame du Saguenay, 1881
Pin blanc recouvert de feuilles de plomb peintes et de feuilles d’or, 7,5 x 2 m
Société historique du Saguenay

Au dix-neuvième siècle, la ville de Québec est dépourvue d’écoles d’art, ce qui ne laisse d’autres choix aux apprentis que d’opter pour une formation traditionnelle auprès d’un maître. C’est dans ce contexte que Louis Jobin commence une formation de trois ans, de 1865 à 1868, dans l’atelier du sculpteur et architecte François-Xavier Berlinguet (1830-1916), et embrasse la carrière de sculpteur. Il passera aussi plusieurs mois à New York pour se spécialiser en sculpture d’enseigne commerciale et de figure de proue. Quand le marché de la sculpture navale décline, les bateaux en bois étant remplacés par des bateaux à vapeur en métal, Jobin se forme à la création de mobilier liturgique et à la statuaire profane. Ce sont ces pratiques qui lui vaudront la reconnaissance dans l’histoire de l’art de la ville et de la province de Québec. Établi dans la capitale de 1875 à 1896, Jobin développe une entreprise prospère d’art religieux et d’enseigne commerciale.
À la faveur d’une spécialité qu’il développe en bois plombé pour la sculpture extérieure, il recrute une clientèle lucrative parmi les membres du clergé et les communautés religieuses. Les commandes d’art sacré proviennent aussi de particuliers, ce qui est le cas du voyageur de commerce Charles-Napoléon Robitaille, le commanditaire de Notre-Dame du Saguenay, qui a été miraculeusement sauvé après avoir invoqué la Vierge Marie lors d’une traversée périlleuse de la rivière Saguenay durant l’hiver 1878-1879. Cet ex-voto est le projet le plus ambitieux de Jobin.


Notre-Dame du Saguenay, qui mesure plus de sept mètres de hauteur sur deux mètres de largeur, est érigée sur le cap Trinité, surplombant le fjord du Saguenay. Malgré son imposant format, Jobin parvient à lui conférer grâce et élégance, par ses proportions élancées et le rendu détaillé des drapés de sa tunique et de son manteau. En bois plombé, la pièce est recouverte de métal et donc à l’épreuve des intempéries.
Gardien de l’œuvre de Jobin, le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) abrite le plus grand nombre d’ouvrages du sculpteur parmi lesquels se distinguent quelques œuvres profanes. Des exemples de sculptures allégoriques du tabac, dont le commerce était en plein essor dans les années 1850, ont été conservés. La figure-enseigne de l’Amérindien, le premier à avoir cultivé la plante du tabac en Amérique, se retrouve immanquablement à l’entrée des débits de tabac, comme en témoigne Big Chief (Grand chef), v.1885, aujourd’hui conservé au musée de Shelburne dans le Vermont, et Indien, v.1885, au MNBAQ. « Les deux Indiens, nobles, héroïques et idéalisés, se rattachent à une catégorie de figures conventionnelles […] caractérisées par une attitude solennelle, par une pose frontale et statique et par des traits stéréotypés. » Leur riche polychromie, moins perceptible aujourd’hui, vise à accrocher l’œil du passant.
Autre exemple de l’étendue du registre de Jobin conservé au MNBAQ : Le char de l’agriculture, dessiné par l’architecte Paul Cousin pour le défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1880. Jobin assume la décoration du char par la réalisation des divers éléments sculptés qui le jonchent, figures mythologiques, corbeilles de fruits et de légumes, animaux dont le castor, outils agricoles, etc. « Par le foisonnement de ses composantes et par le goût de la surcharge dont il témoigne », le char coloré et ses nombreux ornements convient l’esthétique kitsch qui marque le dernier quart du dix-neuvième siècle en sculpture.

 À propos de l’autrice
À propos de l’autrice
 Autres livres d’art en ligne
Autres livres d’art en ligne
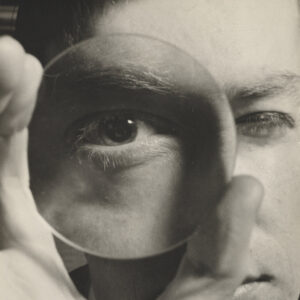 Remerciements
Remerciements