Joseph Légaré (1795-1855)

Joseph Légaré, Paysage au monument à Wolfe, v.1845
Huile sur toile, 132,4 x 175,3 cm
Musée national des beaux-arts du Québec, Québec
Sans doute l’artiste québécois le plus sensible aux idées et aux événements de son temps, Joseph Légaré est une figure dominante de Québec dans la première moitié du dix-neuvième siècle. Son parcours le mène du métier de peintre-artisan à une carrière d’artiste-peintre prolifique, lui qui est estimé comme le père du paysage québécois et qui est de surcroît reconnu comme un collectionneur averti.
C’est en 1812 que le jeune Légaré achève son apprentissage dans l’atelier d’un artisan peintre et vitrier. Cinq ans plus tard, il s’ouvre à la tradition picturale européenne et se met à l’étude des maîtres des dix-septième et dix-huitième siècles en restaurant les tableaux religieux du fonds Desjardins. Le peintre donne une seconde vie à ces œuvres en participant à leur restauration et en en tirant des copies destinées à orner les murs des chapelles et des églises catholiques du Bas-Canada.
Le travail de copiste permet à Légaré d’accéder à un savoir qui l’incite à la recherche de sujets inédits pour ses œuvres. Le massacre des Hurons par les Iroquois, 1827-1828, est exemplaire de ses ambitions. Ce premier grand format du peintre, en même temps que le premier tableau profane d’envergure au Canada, vaut à son auteur une médaille de la Société pour l’encouragement des sciences et des arts en Canada en 1828. L’originalité du sujet y est pour quelque chose. Le peintre représente les Iroquois martyrisant la population huronne christianisée, dans le contexte de la traite de fourrures en Nouvelle-France, à la fin des années 1640. Le drame se joue dans un décor paysagiste romantique, sur fond de nature embrasée par la lumière nocturne qui amplifie l’horreur de l’assaut au premier plan. Le tableau condense l’ambivalence du temps dans la représentation des Autochtones, tiraillée entre les mythes du sauvage sanguinaire et du bon sauvage. Légaré perpétue ainsi les stéréotypes reliés aux Premiers Peuples, tout en les interprétant avec les référents du peintre d’histoire, dans une nudité à l’antique, empruntant les poses des figures héroïques des tableaux européens. Il puise ses sources stylistiques et iconographiques dans les œuvres des peintres Charles Le Brun (1619-1690), Salvator Rosa (1615-1673) et Raphaël (1483-1520), diffusées à l’époque par la gravure que collectionne Légaré.

De son vivant, Légaré peint quelque deux cents œuvres, dont plus de la moitié sont des compositions originales portant sur une grande variété de sujets. L’historien de l’art John R. Porter lui reconnaît d’avoir innové dans le traitement du genre du paysage en ce qu’il serait le premier paysagiste canadien à s’être inspiré de la vision des topographes anglais. Légaré connaissait bien James Pattison Cockburn (1779-1847) duquel lui vient peut-être sa prédilection pour le genre. S’il réalise des paysages qui n’ont d’autres sujets que la nature québécoise, cet intérêt est également manifeste dans ses compositions à teneur historique, comme Paysage au monument à Wolfe, v.1845. Dans cette composition, la figure de l’Autochtone, drapée tel un héros de l’Antiquité classique, est étendue dans un paysage foisonnant qui semble sauvage et inhabité, si ce n’est par le monument à Wolfe trônant au centre de l’image.
La conscience historique de Légaré et son intérêt pour l’actualité l’incitent à se faire chroniqueur de son temps. Il met en images certaines des catastrophes qui affligent Québec et sa population dans les années 1830 à 1850, l’épidémie de choléra en 1832, l’éboulis du Cap-aux-Diamants en 1841, ainsi que les incendies des quartiers Saint-Jean et Saint-Roch en 1845, parmi d’autres événements. L’originalité de Légaré tient dans son œuvre engagée socialement et politiquement, à vrai dire comme l’homme l’était lui-même dans sa ville. Reconnu comme un nationaliste, Légaré prend part aux rébellions des Patriotes qui le conduisent brièvement en prison en 1837, après quoi il tentera de s’impliquer en politique active à Québec.
L’immense contribution de Légaré peintre est aussi déterminante pour la ville que celle du connaisseur assemblant une collection colossale. Dès les années 1820, il commence à acquérir des tableaux, d’abord du fonds Desjardins, puis de sources diverses, ainsi que des estampes en grand nombre. À son décès, en 1855, sa collection compte plus d’un millier d’œuvres, dont 162 peintures en art canadien et européen. À partir de ce vaste ensemble, Légaré a mis sur pied trois galeries de peintures qui se sont succédé entre 1833 et 1872 à la Haute-Ville de Québec et qui ont fondé les bases du premier musée d’art au Canada, la Pinacothèque de l’Université Laval, ouvert en 1875.

 À propos de l’autrice
À propos de l’autrice
 Autres livres d’art en ligne
Autres livres d’art en ligne
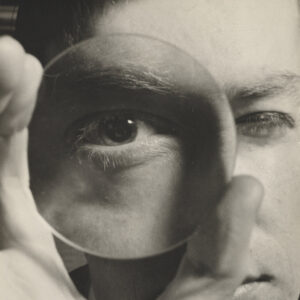 Remerciements
Remerciements