Laurent Amiot (1764-1839)

Laurent Amiot, Encensoir, v.1820
Argent, 24,2 cm (hauteur) x 11,5 cm (diamètre)
Musée national des beaux-arts du Québec, Québec
La protection et le mécénat de l’Église catholique favorisent la longue et florissante carrière du maître orfèvre Laurent Amiot à Québec. Ce fils d’aubergiste est le premier orfèvre de la province de Québec à être formé en Europe. C’est le Séminaire de Québec qui agit à titre d’intermédiaire et qui organise sa formation à Paris, comme pour le peintre et sculpteur François Baillairgé (1759-1830) quelques années auparavant.
Amiot quitte Paris à la veille de la Révolution française après y avoir passé cinq ans, de 1782 à 1787. Les modèles – bénitier, lampe de sanctuaire, encensoir et navette, reliquaire, calice, ciboire – qu’il développe après 1788 feront sa gloire : Amiot sera reconnu à Québec pour son orfèvrerie cultuelle largement diffusée au début du dix-neuvième siècle. Ses pièces d’art religieux aux formes épurées donnent à voir le style néoclassique à la mode en France dans les années 1780, qu’Amiot répand dans la capitale.

Comme Amiot a surtout créé pour l’Église, il laisse de rares témoignages en orfèvrerie domestique. D’une part, l’élégante Théière Regency, v.1815, récemment découverte et conservée au Musée des beaux-arts du Canada, est un « petit monument de cohésion et de finesse », qui se distingue par la grande stylisation, la symétrie et l’équilibre de ses composantes, comme le décrit l’historien de l’art René Villeneuve. D’autre part, la Coupe présentée à George Taylor, 1827, commandée par le gouverneur Lord Dalhousie (1770-1838) pour célébrer l’inauguration en mai 1827 du navire Kingfisher dont Taylor a veillé à la construction. Pour rappeler l’identifié du commanditaire, la prise de main du couvercle reprend le motif de la licorne figurant dans les armoiries du gouverneur. Amiot est le seul artiste canadien-français encouragé par Dalhousie, alors qu’il était plus naturel pour les riches mécènes de se tourner vers Londres pour la création de ce type d’œuvre. La coupe à l’allure sculpturale est exemplaire du travail collaboratif qui marque alors la pratique du métier : la tête de licorne a probablement été sculptée par François Baillairgé tandis que le graveur écossais James Smillie Jr. (1807-1885) se serait chargé de la gravure ornant la face principale du vase.
Entouré d’apprentis, Amiot verra à changer le nom de sa « boutique » pour en faire un « atelier », afin de bien différencier les lieux de fabrication et de vente de sa production. L’artiste-entrepreneur base sa stratégie de mise en marché sur le prestige de sa formation parisienne, et il remplace aussi le mot « métier » par « art », se qualifiant lui-même de « maître ès art orphèvre » dès 1816. L’orfèvrerie constitue chez Amiot une expression artistique accomplie, au même titre que la peinture, la sculpture et l’architecture, en témoignent les dessins préparatoires de ses œuvres qu’il compose dans la plus pure tradition académique, en accord avec sa formation européenne.
L’orfèvre Amiot est doué d’un sens des affaires qui lui apporte la fortune : il « entre de plain-pied dans l’ère proto-industrielle en établissant un atelier et des modèles qui lui survivront depuis plus d’un siècle ». Si bien que le nouveau style qu’il importe de France est bientôt adopté par ses concurrents de Québec et de Montréal. Les commandes affluent des milieux ecclésiastique, bourgeois et gouvernemental pendant les cinquante-deux années d’opération de l’atelier d’Amiot.

 À propos de l’autrice
À propos de l’autrice
 Autres livres d’art en ligne
Autres livres d’art en ligne
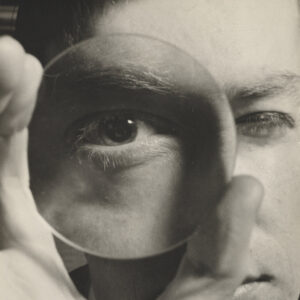 Remerciements
Remerciements